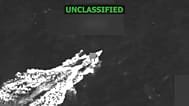Entre 2022 et 2024, les entreprises italiennes ont payé environ 1,2 milliard USD d'impôts à la Russie, dont la moitié a été consacrée aux dépenses militaires pour financer la guerre en Ukraine, comme le confirment les données recueillies par le projet "LeaveRussia" de l'École d'économie de Kiev
Les données ont été compilées par la Kse, l'école d'économie de Kiev. Pour le directeur adjoint du développement et chef du projet "LeaveRussia" Andrii Onopriienko, entendu par Euronews, les impôts payés par les entreprises italiennes actives en Russie représentent environ 1,2 milliard de dollars dans les caisses du Kremlin pour la seule période de 2022 à 2024.
Environ la moitié de cet argent, confirme M. Onopriienko, "a été investi dans des dépenses militaires pour financer la guerre contre l'Ukraine". L'estimation, selon l'institut, est donc d'environ 400 millions de dollars de contributions versées par les entreprises italiennes à Moscou chaque année. Un chiffre conforme aux valeurs de la période précédant le déclenchement de la guerre.
Des entreprises italiennes toujours présentes en Russie
Le site web du projet "LeaveRussia", édité par le KSE, a été créé dans le but de suivre les activités des principales multinationales opérant en Russie après le déclenchement de la guerre. La base de données, consultable en ligne, classe les entreprises en fonction de leur pays d'origine, du secteur dans lequel elles opèrent et de leur "statut". En d'autres termes, il s'agit de savoir si elles sont toujours actives commercialement dans le pays, si elles ont suspendu leurs activités ou si elles ont quitté la Fédération à la suite de sanctions.
À ce jour, selon les dernières données actualisées fournies par le KSE et "LeaveRussia", environ 140 entreprises italiennes opèrent en Russie. Toutefois, une trentaine d'entre elles ont déjà annoncé qu'elles souhaitaient quitter le pays, tandis qu'environ 70 ont conservé un bureau légal sur le territoire russe. Les autres entreprises continuent à exporter vers la Russie.
La méthodologie utilisée, comme l'explique le site web du KSE, repose sur des informations recueillies auprès de diverses sources : autorités fiscales russes, informations financières disponibles en ligne, suivi des communiqués de presse publiés par les différentes entreprises.
En tête de liste : les États-Unis et l'Allemagne
Ferrero, Barilla, Calzedonia sont quelques-uns des noms des groupes qui, selon la base de données "LeaveRussia", ont maintenu des activités commerciales avec la Fédération. Parmi ceux qui ont quitté la Russie - huit groupes au total sont mentionnés - figurent Enel, Eni et Moncler.
Toutefois, selon les données de "LeaveRussia", l'Italie ne figure pas parmi les premiers pays au monde pour le nombre d'entreprises encore actives dans le pays. Les États-Unis et l'Allemagne sont en tête de liste, suivis par le Royaume-Uni.
Toutefois, l'Italie fait partie des pays européens qui comptent le plus grand nombre d'entreprises encore actives en Russie, selon les dernières données traitées par le KSE pour le mois de septembre de cette année.
Sanctions et sortie des entreprises du marché russe : un tableau complexe
Pour mieux comprendre la relation entre les sanctions et les activités des entreprises italiennes dans la Fédération de Russie, et pourquoi un grand nombre d'entre elles continuent d'opérer dans le pays, nous avons parlé au professeur Carolina Stefano, professeur d'histoire et de politique russe à l'Université Luiss de Rome.
Carolina Stefano explique à Euronews que le tableau est complexe : " Tout d'abord, il existe une zone grise de commerce qui existe au-delà des données collectées et qui est constituée d'entreprises qui ont quitté le marché mais qui parviennent à passer par d'autres canaux.
"Dans ce cas, bien que de manière réduite, les entreprises continuent à faire des affaires avec la Russie, à un coût très élevé. Il s'agit de transports triangulaires qui se multiplient et commencent à peser sur l'économie russe".
Le conférencier explique également que dans certains cas, tous les produits ne sont pas sanctionnés, ce qui permet à certaines entreprises de continuer à commercer avec la Russie en toute légalité. "De plus, ajoute le conférencier, le Kremlin a également introduit des mesures qui ont augmenté les coûts pour ceux qui décident de quitter le marché russe.
Approbation des sanctions, "beaucoup d'entreprises se sont senties exclues"
"Enfin, il y a aussi un problème lié au processus de prise de décision qui a conduit à l'approbation des paquets de sanctions. De nombreuses entreprises se sont senties exclues à ce stade, compte tenu de la rapidité de la diplomatie européenne", explique Stefano.
Elles n'ont pas eu l'impression de faire partie de cette initiative et ont ressenti un sentiment d'injustice, surtout si la priorité accordée à la promotion d'une initiative européenne s'est ensuite répercutée différemment sur les différents pays".
Les conséquences pour La Russa et l'impossibilité de revenir à une "économie civilisée
Dans un discours publié sur le site du Carnegie Russia Eurasia Centre, Alexandra Prokopenko, ancienne employée de la Banque centrale russe et aujourd'hui chercheuse au Carnegie, évoque le poids que les sanctions ont eu sur le pays jusqu'à présent et surtout le fait qu'elles empêchent toute perspective de croissance économique. Raison pour laquelle, explique Prokopenko, "il sera très difficile pour le pays de passer d'un modèle d'économie de guerre à un modèle d'économie civilisée".
Les causes sont multiples : baisse de la compétitivité des produits civils et militaires, procédures devenues complexes et coûteuses en cas de recours à des intermédiaires commerciaux. Et puis il y a aussi l'effondrement des profits du secteur de l'énergie. En particulier le pétrole et le gaz, qui sont également touchés par les sanctions.
Après 2022, commente M. Prokopenko,l'économie russe a radicalement changé.
Les dépenses liées au secteur militaire et de la défense ont doublé, passant d'environ 4 % à 8 % du PIB.
Aujourd'hui, ajoute-t-il, elles représentent 40 % du budget total de l'État, un phénomène qui a entraîné une hausse de l'inflation face à une capacité de production industrielle limitée et à une réduction globale des importations.